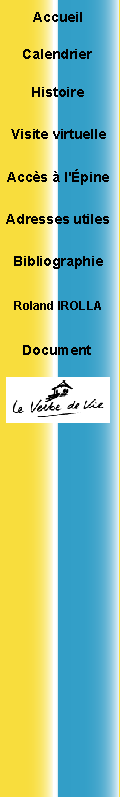
Mon père, Joseph CAQUÉ, né en 1887 et ma mère Alice MONTEL SAINT-PAUL, née en 1891, ont été formés à l'école de Jules Ferry qui enseignait les valeurs solides et indiscutables de la mère Patrie et du labeur bien fait, celle qui inculquait le respect du pain gagné à la sueur de son front.
J'avais deux ans quand éclata, la terrible conflagration qu'on appela, la Grande Guerre puis la Première Guerre Mondiale. J'avais un frère, Léon, mon aîné d'à peine un an. Nous habitions à L'Epine, à huit kilomètres à l'est de Châlons-sur-Marne, au bord de la route nationale no 3, non loin de la magnifique basilique.
Mon père fut mobilisé, vécut tous les moments les plus atroces de cette guerre et vit tomber autour de lui, à Verdun, ses camarades fauchés lors des attaques des tranchées ennemies. Son courage et son ascendant sur ses compagnons de combat lui valurent des galons, de sorte qu'il était lieutenant lorsque l'armistice mit fin au cauchemar.
De son côté, au village, ma mère., devenue chef de famille et d'exploitation agricole, assumait de lourdes responsabilités. Je n'ai gardé que quelques souvenirs de cette période. Craignant l'arrivée des Allemands, lors de la première bataille de la. Marne, de nombreux habitants de L'Epine ont émigré avec chevaux et voitures à moisson au chargement hétéroclite. Ma mère, elle, n'a jamais voulu partir : "Tué pour tué, autant mourir ici" disait-elle. J'ai le souvenir d'un soir où, la canonnade étant toute proche, continue et menaçante, nous nous sommes réfugiés, ma mère, mon frère et moi dans un souterrain sous le terrain du presbytère, avec quelques personnes que je ne connaissais pas. Ce fut la seule fois où nous dûmes nous protéger. Lors d'un incendie provoqué par les Allemands, plusieurs maisons furent détruites sur le bord sud de la route nationale à l'entrée ouest du village.
Mon père avait obtenu qu'Albert COLLARD, chef de famille nombreuse, soit démobilisé et employé dans notre ferme. Il y demeura, vingt-six ans.
La guerre terminée, mon père resta. marque par ces quatre années terribles et aussi,, certainement., par l'habitude du commandement que les événements et les galons lui avaient donnée. C'était aussi une époque où la discipline était stricte, à l'école comme en famille. Nous n'avions pas le droit de parler à table. Il m'est arrivé de manger debout, hors de la cuisine, en manière de punition. J'étais honteux quand un visiteur me trouvait ainsi puni 3 cela, me faisait mal.
A l'école où le maître, Monsieur MADOSSE, était sévère, je n'avais pas de bons résultats comme mon frère Léon. "Ça ne voulait pas rentrer" disait-on. Ma mémoire était rebelle, ma compréhension laborieuse. Je faisais pourtant des efforts, couronnés parfois, à mon grand désespoir, de séances de pain sec. J'ai souffert, mais j'ai cependant toujours soutenu mon application. Je dus "redoubler" l'année préparatoire au certificat d'études primaires. Année pénible au cours de laquelle il fallait mémoriser "un tas de choses". Le jour de l'examen,, le grand jour, mon coeur battait à grands coups. Il me semblait qu'on devait l'entendre autour de moi. De bon matin, nous sommes partis pour Marson, le chef-lieu de canton, dans un break,, avec la mère de Jean MATTLIN, l'un des trois candidats de L'Epine. Mon père et Monsieur MADOSSE faisaient voyage à part. Longue journée où les nerfs étaient à rude épreuve. Le "certif" était pour nous l'EXAMEN. Mon père m'avait dit : "Si tu n'es pas reçu, tu reviendras à pied". Toujours des menaces, peu de compliments ... Victoire ! Mon nom figurait sur la, liste des élus. Tenant sa promesse, mon père m'offrit une bicyclette, un vélo à guidon noir, réformé de l'armée. Vélo tout de même. J'avais treize ans. J'entrais dans le monde des travailleurs., libéré des lourds soucis scolaires.
Cependant, dès l'âge de cinq ou six ans, mon frère et moi avions déjà nos tâches domestiques régulières "passer au pain" à la sortie de l'école, mettre la table, aller tirer le vin du tonneau dans des litres, rentrer du bois pour la cuisinière, le fagot pour la cheminée, préparer, près de la porte de l'écurie, les bottes de foin et de paille de blé pour les chevaux. Le samedi, nous devions nettoyer la cour au balai de bouleau.
Le soir, à la sortie de l'école, l'abbé GIBART, nous attendait pour réciter la prière et le jeudi pour nous enseigner le catéchisme, le caté. Et puis à sept ou huit ans, nous devenions enfants de choeur. Nous étions six à servir la petite messe de sept heures, à tour de rôle. Il fallait alors se lever tôt mais nous gagnions cinq sous (vingt-cinq centimes) par semaine. Le service d'une messe de mariage nous rapportait une "pièce" et celui d'un baptême, un cornet de dragées accompagné d'une "petite pièce".



Rien de plus facile que de, faire des gaufres aujourd'hui avec un gaufrier électrique. Dans les années 1920, il fallait manier habilement les deux lourdes plaques de fonte à long manche du gaufrier posé sur un trépied dans la cheminée, graisser les plaques quadrillées avec un morceau de lard piqué au bout d'une fourchette, verser une louche de pâte liquide, former vite le gaufrier et le retourner. Le cuisinier que j'étais devait aussi conduire sous le trépied un feu vif de fagots et de bois sec fendu fin. Le temps de cuisson s'évaluait empiriquement. La gaufre était rapidement retirée aux pointes d'une fourchette, les plaques graissées à nouveau, et hop 1 à la gaufre suivante. A cette époque où les friandises étaient rares en général et chez nous tout particulièrement, les gaufres constituaient un régal et leur soirée un évènement mémorable.
Si nos petites tâches quotidiennes d'enfants nous semblaient faciles, les travaux des champs épuisaient nos jeunes forces, pendant les grandes vacances. Mon père m'envoyait, à Melette, aider Constant BAYEN à moissonner. Autrefois, lorsqu'un champ de céréales avait pour voisins des champs non récoltés, il fallait le dérayer, c'est-à-dire l'"entamer" sans endommager les riverains. Les chevaux passaient dans la céréale, le long de la roie à l'aller, la moissonneuse-lieuse fauchant la bande suivante. Au retour., elle coupait celle que les chevaux avaient piétinée. Alors, je suivais la machine pour déplacer les gerbes d'un côté puis de l'autre, pour dégager le passage. Ensuite, la voie ouverte, la fauchaison continuait sans problèmes et je dressais les gerbes en tas de cinq. Les gerbes de blé pesaient lourd dans mes petits bras mais le travail me plaisait et j'avais la fierté d'être utile. A l'heure de la pause, le pain et le chocolat accompagnes d'une chopine d'eau sucrée au sirop ragaillardissaient le jeune moissonneur fatigué.
A l'automne, le dimanche, nous allions aux sapinettes. A cette époquelà, les territoires de la Champagne crayeuse, qu'on appelait encore la "Pouilleuse", étaient boisés à vingt ou trente pour cent alors qu'ils ne le sont plus que de zéro à huit ou neuf pour cent. Les terres les plus éloignées des villages portaient des pinèdes produisant des pommes de pins ou sapinettes à profusion. Nous les ramassions, celles plus grosses des pins noirs d'Autriche surtout, pour allumer le feu dans la cuisinière. Nous en rapportions cinq ou six sacs dans la voiture tirée par Bichette.
L'ADOLESCENCE
A la sortie de l'école, riche de mon certificat d'études, j'entrai donc dans le monde du travail en pleine moisson. Nous avions cinq chevaux pour cultiver cinquante deux hectares. Deux ouvriers agricoles secondaient mon père et mon frère qui travaillait déjà avec deux chevaux. Je mettais les gerbes en croix de dix-sept. J'appris aussi. à faire des voitures de gerbes. Il faut placer les gerbes ou sur le chant ou à plat, certaines débordant du plateau de la voiture, d'autres au milieu dans un sens et dans le sens opposé. "Serre-les bien avec ton genou" disait mon maître d'apprentissage, le père COLLARD, un homme habile et patient. Aîe j'avais des piquants de chardon dans les doigts. La voiture terminée et bien serrée par la corde, je m'empressais de descendre pour regarder mon oeuvre, de derrière. Bon ! elle était bien équilibrée, alors j'étais fier. Ou bien, ah ! malheur, elle faisait le ventre à droite. Hum ! Pourvu qu'elle ne "vêle" pas (qu'elle ne se vide pas) en route, dans les cahots des chemins. Ça n'est jamais arrivé. J'avais un bon maître.
Lorsque la grange était pleine de foin et de gerbes, nous élevions des meules rondes dans les champs. Mon père façonnait la meule avec une sûreté que je lui enviais. C'était toujours un chef - d'oeuvre. Je lui passais les gerbes avec une fourche. Mais pas n'importe comment. Il me fallait suivre l'élaboration des rangs successifs et jeter la gerbe pour qu'elle arrive à la bonne place et dans le bon sens. Sinon, gare aux foudres paternelles !
Nous fêtions la fin de la moisson avec un gâteau, que ma mère confectionnait avec amour, accompagné d'une "bonne bouteille".
Puis vint mon premier labour à la charrue simple avec un seul cheval. Ce ne fut pas facile, mais je prenais goût au travail des champs et m'y appliquais. Arrachage des pommes de terre, des betteraves,, charroi et épandage des- fumiers, labours, hersages, chaulage des semences, semailles d'automne... En hiver, nous soignions les moutons à la bergerie : nettoyage des crèches,, distribution de la provende, "mondage" c'est-à-dire enlèvement du fumier, etc ... Par temps de neige et de pluie, la batteuse, servie par quatre hommes., ronronnait toute la journée, avalant goulûment les gerbes déficelées et restituant la paille d'un côté, la menue-paille d'un autre et un filet continu de grains dorés qui remplissaient de grands sacs de jute. Le van parachevait le travail de la batteuse. Le grain versé dans la trémie coulait doucement dans le courant d'air produit par les pales de la roue qu'entraînait la grande manivelle tournée par un homme. Les menues-pailles restantes étaient chassées vers l'arrière, les grains tombaient sur plusieurs grilles inclinées et animées de mouvements latéraux qui les séparaient des "hautons" ou grosses impuretés et les triaient en petits grains, grains casses,, graines d'herbes adventices d'un côté et bon grain plein de l'autre.
C'est en hiver aussi que nous abattions les sapins pour le chauffage domestique. Le repas de midi pris près d'un feu de branches sèches où nous mettions à chauffer notre gamelle, griller notre pain et notre viande, nous faisait oublier la fatigue. Le barbecue avant la date !
Au cours de la mauvaise saison, il arrivait que nous préparions des petites bottes de paille de seigle, appelées "glues", d'un poids de cinq kilos. Pour cela., sur l'aire de grange bien balayée, des gerbes de seigle étaient disposées sur deux rangs. Au fléau , mon frère et moi battions les épis, sur une face puis, les gerbes retournées, sur l'autre. Les gerbes déficelées étaient secouées et la paille mise en bottes serrées par des liens de paille. Ainsi battues au fléau et non passées dans la batteuse, les gerbes laissaient une paille indemne de toute brisure. Bien peignés et taillés, ces gluis, vendus à Jacques SIMON de Saint-Memmie,, servaient à la confection de paillons à fromages.
Le ronronnement de la batteuse, le vlan, vlan, vlan saccadé et monotone du van, le pan, pan, pan sourd du fléau animaient la forme par les mauvais temps d'hiver.
Mon père ayant loué dix-sept hectares de terres nouvelles en 1927, notre travail devint plus important. Le formage était alors d'un demi-quintal de blé et d'un demi-quintal de seigle à l'hectare. En 1987, il est de six quintaux de blé pour un bail de dix-huit ans.
Pour rompre le rude labeur manuel., deux fois par semaine, après le repas du soir, nous allions apprendre le solfège et la musique, chez l'instituteur de Courtisols, Monsieur DEWEZ. Nous jouions à la fanfare, la Renaissance. Beaucoup de jeunes gens des villages voisins se rencontraient là et bavardaient tard dans la nuit après les répétitions ou faisaient des farces avant de rentrer chez eux sur leur bicyclette éclairée par une lanterne où brûlait une bougie.
L'année 1926, fut marquée par la naissance d'un petit frère et l'arrivée du courant électrique dans la ferme. La tension était de cent-dix volts pour la lumière et de deux-cent-vingt volts pour la force. Quel changement dans notre vie ! Quel éblouissement ! Des ampoules de vingt-cinq watts (on disait vingt-cinq bougies), rendez-vous compte 1 C'était un progrès sur l'éclairage à acétylène installé dès 1920. Fin 1926, début 1927, l'eau courante fut
distribuée dans le village. Tout arrivait en même temps pour nous faciliter la vie. L'outillage électrique remplaça petit à petit les appareils manuels à la forme.
Nous devenions, Léon et moi, des jeunes gens solides et connaissant leur travail. Alors, mon père, comme beaucoup de Champenois de la "Crayeuse", commençait de prendre du bon temps en chassant le lapin de garenne plusieurs jours par semaine et nous faisait de Plus en plus confiance pour des travaux parfois difficiles. Il m'est arrivé, âgé seulement de seize ans, de conduire des chevaux chez le maréchal-ferrant dont la forge ouvrait sa grande porte sur l'actuelle place du Marché-aux-Fleurs, à Châlons. Il me fallait tenir les pieds que Monsieur BROUET ferrait. Pour un novice, ce n'était pas une partie de plaisir, je vous assure. Mes muscles allaient jusqu'au bout de leurs forces et mes yeux pleuraient dans l'âcre fumée de corne brûlée. Le père BROUET, riant, m'encourageait en disant : "Ce n'est rien, fiston, c'est le métier qui entre et tu te débrouilles bien". Plus tard, quelques accidents ont fait entrer le métier plus durement encore : un taureau m'a rudement bousculé et malmené 3 d'un coup de sabot, un cheval grincheux m'envoya contre le mur, douloureusement touché au bas-ventre.
L'ACCIDENT
Enfin, le 27 mai 1933, un accident plus grave changea le cours de ma vie. J'allais chercher de la grève avec deux chevaux et un poulain. Le village traversé, je montai dans le tombereau. Le poulain, un peu fou, mordillait le cheval de devant qui n'appréciait pas ce jeu et répondait par des coups de sabot jusqu'au moment où, excédé, il prit le galop. Je bondis alors sur le limonier (le cheval attelé dans les limons) pour saisir les rênes et stopper l'emballement. Le calme revenu, je sautai à terre afin de mieux maîtriser mon attelage excité. Malheureusement, le bruit de ma chute effraya les chevaux énervés qui partirent à nouveau dans une course effrénée. Tirant sur le cordeau de toutes mes forces, je restai impuissant, entraîné, couché sur le côté, les genoux rabotés, la ceinture de flanelle en lambeaux... A bout de forces et meurtri, je lâchai prise. Une roue du tombereau me passa sur le corps dans la région lombaire ... "Il faut le conduire de toute urgence à l'hôpital". Mon oncle, le boucher, fut sollicité. Il lui fallut vider sa camionnette dans laquelle un matelas fut allongé. Mon ambulance de fortune m'emmena à l'Hôtel-Dieu, rue de la Marne, en face du monument aux morts. Ce jour-là, la ville de Châlons recevait le Président de la République, Monsieur Albert LEBRUN : le défilé des troupes prolongea mon séjour incommode dans la voiture imprégnée de l'odeur de la, viande. Enfin, le soir-même , Monsieur PRIOLLET, le chirurgien, faisait l'ablation de mon rein gauche éclaté. Un mois d'hôpital, deux ou trois mois de convalescence. Il n'est pas question de reprendre les durs travaux de la ferme. Alors, des professions qui me sont proposées, je choisis d'embrasser celle de berger. Ce n'est pas une vocation, mais j'aime les moutons et la nature. Et puis, nous avons, à la ferme, une centaine de brebis auxquelles nous donnons quelques soins à la bergerie : préparation et distribution de la provende, surveillance des agnelages, adoption des agneaux par leur mère, etc. J'ai donc déjà quelques notions concernant l'élevage ovin. Durant ma convalescence, j'accompagne le berger de L'Epine et m'intéresse particulièrement au travail des chiens, dans les champs, dans les chemins. En avril 1934, je prends notre troupe en main avec ma chienne Mascotte.
L'APPRENTI-BERGER
Le premier jour, ma troupe ne compte que cent quarante quatre bêtes. Je ne m'éloigne pas trop du village. Mascotte essaie de bien faire. La première sortie est assez encourageante. Le lendemain, enhardi par le succès de la veille, je conduis mes brebis dans le plou (le savart) de la mère LANEAUX, grande friche de six ou sept hectares, au nord-est de Melette (23). Cette fois, la partie n'est pas aussi facile. Quelques gourmandes vont chiper des goulées au bord des champs voisins. Mascotte, inexpérimentée comme son maître, se démène sans grand succès. Je dois aller à droite, à gauche, pour "rattrouper" les indociles, Le soir, au retour, je suis un peu déçu. Aussi décidè-je, de me procurer, sans plus attendre, un second chien, un chien de rive expérimenté. Un berger de La Cheppe me prête sa chienne Lionne. Lors de la première sortie avec mes deux chiennes, je crains que Lionne ne retourne chez elle. Je suis vite rassuré, la bonne bête se met au travail comme une ouvrière consciencieuse. Elle sait se fa-ire obéir,, elle. Un coup de dents au jarret des brebis indociles et la troupe broute calmement l'herbe courte du plou ou du chemin. Le "métier" de cette chienne a suffi pour me rendre espoir et courage. Après quatre ou cinq sorties, comme tous les novices, je me sens déjà berger et heureux de l'être .
Eprouvant cependant le besoin de connaître bien le métier, je m'abonne à une revue professionnelle : L'Union ovine (24)*. J'y trouve l'offre de chiens de berger, de race briarde, âgés de deux mois. Commande est passée. Deux petites boules de poils noirs m'arrivent : mes chiots, mes futurs compagnons de travail, Réveil et Charmante.
LE BERGER COMMUN
Le 11 novembre 1934, les deux autres propriétaires de moutons de L'Epine, C. C. et P. G., me demandent de prendre leurs troupes. Je suis "loué" : berger commun de 251 brebis. Je gagnerai, 8 000 F 11 an. En 1939, je garderai jusqu'à 428 moutons (je devrais dire "ovins") et 5 chèvres ; en 1943, jusqu'à 483 de quatre propriétaires et seulement 352 en 1945 après le départ d'un fermier.
LES MOUTONS
Tous ces moutons sont de la. race Ile-de-France, issue de croisements de métissage entre la race anglaise dishley et la race mérinos (brebis mérinos + bélier dishley = dishley-mérinos 3 brebis dishley-merinos + bélier mérinos = métis 1/4 sang dishley et 3/4 mérinos 5 la sélection de ces métis de type unique a donné la race Ile-de-France). La brebis Ile-de-France est assez petite, a des membres fins, des hanches écartées, une croupe longue. C'est un animal précoce à deux fins., alliant une excellente conformation pour la, viande à une toison assez fine et lourde.
OUTILS ET ACCESSOIRES
En vue d'assurer la meilleure conduite possible de ces brebis, je me suis procuré les outils et accessoires que doit posséder tout bon berger.
Avec la corne, j'annonce mon arrivée, le matin, au départ, de sorte que les propriétaires font lever leurs bêtes a moins qu'elles ne m'aient entendu et se soient levées d'elles-mêmes. Ce mouvement est accompagné du relâchement de deux sphincters : les bêtes font leurs besoins. C'était, autrefois surtout, une production précieuse qu'il ne fallait pas perdre. Pour vous en convaincre, je vais vous faire connaître le résultat d'une enquête et une technique agricole de la Champagne châlonnaise. En 1762, l'intendant de Champagne demande à ses subdélégués de répondre à un long questionnaire relatif à l'élevage ovin. Une question concerne l'importance accordée par les laboureurs de la généralité aux trois principales productions des moutons : la laine, la, viande et le fumier. Sept subdélégués sur neuf notent clairement que leurs paysans donnent la priorité au fumier, vient ensuite la laine, en dernier la viande (21). Ils ajoutent tous que le fumier de mouton est réservé à l'amendement des terres à froment. Il faut dire aussi qu'à cette époque la viande de mouton n'est guère appréciée. D'ailleurs, il ne semble pas qu'on ait mangé de l'agneau ou bien peu. Le mouton était élevé jusqu'à l'âge de trois ou quatre ans pour sa, production de fumier et de laine. Il était ensuite engraissé pour la boucherie. Sa chair avait alors une saveur forte. Jean de Brie (8, voir aussi p. 10) nous dit, vers 1379, que les écoliers (étudiants) à Paris, à Orléans, en mangent. Mais sans doute parce qu'elle ne leur coûte pas cher, les étudiants étant habituellement impécunieux. On mangeait tout,, dit encore le maître en bergerie : "tripes, tête, pieds, foye, poulmons, prouffitables aux pauvres gens". "Ce n'était pas mets de roi" écrivent R. Grand et R. Delatouche (7).
"Un arrêté pris à Paris, en 1701, défend à tous les éleveurs de moutons de tuer des agneaux ou d'en vendre pour tuer, à quelle qu'époque que ce soit si ce n'est dans l'étendue de dix lieues à la ronde de Paris où l'abattage pour les agneaux de lait est autorisé depuis Noël jusqu'à la Pentecôte" (9, p. 234, note 4).
Dans l'enquête de 1762 (21), à la, question "A quel âge engraisse-t-on les moutons qu'on mène aux foires pour l'usage de la boucherie ?", il est répondu de 3 à 6 ans. A la question "Fait-on commerce d'agneaux de primeur depuis Noël jusqu'aux jours gras ?", la réponse unanime est "non", avec cette restriction : "quand on en achète c'est pour remonter le troupeau".
Voici maintenant la technique agricole pratiquée au cours des XVIIIe et XIXe siècles et peut-être avant. On disait autrefois "sans fumier, la terre de Champagne crayeuse est stérile,, avec du fumier en suffisance, elle produit en abondance et en qualité". Conscients de cet état de fait., les laboureurs de Courtisols et des villages voisins creusaient de vingt ou trente centimètres le sol de leur bergerie et comblaient cette excavation avec la terre arable d'un champ voisin sur laquelle reposait une mince litière de paille. Durant plusieurs mois, cette terre recevait et retenait "les sels féconds de l'urine et de la fiente des animaux", après quoi on la charriait où elle avait été prélevée. Ainsi., d'année en année, des champs, proches du village, fumés copieusement, étaient en mesure de produire de belles récoltes de chanvre et de froment surtout.
Si la Champagne crayeuse, de par son aridité naturelle, a un besoin absolu de fumier., l'agriculture des autres régions, même de bonne fertilité, a toujours eu besoin de fumier, le seul, engrais disponible pendant des siècles. E. Millet (12) écrit, à propos de l'élevage ovin dans la, Meuse, au milieu du XIXe siècle : "Le mouton est élevé avant tout pour son fumier et sa laine qui approvisionne les "tissiers" de village encore nombreux".
Avant 1870, des troupeaux transhumants de Meurthe-et-Moselle et du BasRhin, passaient toute la belle saison sur des territoires de l'est meusien (Fresne-en Woëvre, Etain ... ). Ils avaient accès aux jachères, chaumes et friches sous la seule condition du parcage sur les champs des propriétaires locaux tenus eux-mêmes de fournir à tour de rôle la nourriture des chiens de berger (E. Millet, 12, P. 50). Repris en 1924 jusqu'en 1934-1935, ce parcage des transhumants s'est généralisé dans le département de la Meuse, avec 31 troupeaux dont 23 du Bas-Rhin, comptant au total 11 359 moutons de race würtembergeoise, rustique et endurante à la marche. Le parcage consistait à faire passer la nuit au troupeau dans un parc fait de claies mobiles, celui-ci étant déplacé tous les jours de façon à fumer (amender) les champs en totalité. On considérait qu'un mouton assurait la. fumure d'un mètre carré en six heures. En moins d'un mois, un troupeau de 400 bêtes fumait copieusement un hectare. En Champagne, le parcage était pratiqué de la Saint-Jean (24 juin) au mois d'octobre. Certains bergers déplaçaient même le parc au milieu de la nuit.
De l'enquête de 1762 (21), à la question "parcage" nous tirons les réponses suivantes, de l'élection de Reims : "On parque pendant trois mois, juillet, août, septembre; le reste de l'année, les brouillards et l'humidité donneraient des maladies"; de l'élection de Châlons : "Il n'y a que les troupeaux des seigneurs qu'on fait parquer. Il y aurait une sorte d'impossibilité à faire parquer ceux des communautés, chacun voudrait comme de raison, participer à l'avantage du parc... La répartition serait bien difficile... tel laboureur ayant cinquante bêtes dans le troupeau, tel autre n'en ayant que cinq ou six". Dans les autres élections, à l'exception de celle de Château-Porcien, on ne parque pas.
Le berger de Sarry, Monsieur Célestin FRANCO1S, Mosellan d'origine, conduit une troupe de 300 à 350 mères, résultat du croisement würtembergeois-hampshire, des bêtes rustiques dont il est propriétaire. Il parque toutes les nuits de la belle saison de 1945 à 1955, amendant de nombreuses terres éloignées du village, moyennant deux litres de lait quotidiens et la nourriture des chiens. Puis l'évolution agricole de la "Crayeuse" est telle que les parcours à moutons se raréfient. Prudent, Monsieur FRANÇOIS achète en 1962, quelques terres qui, le remembrement terminé, lui permettent d'établir, à partir de 1964, un grand parc grillagé qu'il cloisonne en pâturage tournant. Jusqu'à la moisson, ses moutons sont au parc. Ensuite, il les fait paître dans les chaumes. A la fin de l'arrière-saison et dans l'hiver, les prairies naturelles de la vallée de la Marne leur proposent un reliquat d'herbes plus ou moins sèches. Le bon berger n'est pas un simple meneur de moutons, il sait tirer parti de tout ce qu'offrent les champs; il ne gaspille rien. J'aurai l'occasion de vous le dire à nouveau. Monsieur FRANÇOIS donne peu de foin à ses bêtes, en hiver. En revanche , elles reçoivent de la paille, aliment et litière, à discrétion. Un agriculteur procure au berger toute la paille de blé qu'il veut et, en contre-partie, dispose du fumier produit. Monsieur FRANÇOIS a pris sa retraite, sans successeur, en 1980. Au cours des décennies 1970 et 1980, le fumier perdra la grande valeur qu'il avait auparavant et l'agriculture de la Champagne crayeuse en fera fi (le "Robert" dit fi : radical de fimus, le fumier).
Après cette longue digression "fumier", je reviens à ma corne. A mon coup de corne du matIn, le porte-rue s'ouvre, les moutons de P. G. puis ceux de C.C. se joignent aux nôtres J.C. Et en avant pour la campagne. A mon coup
de corne du soir, les portes s'ouvrent et chaque groupe de bêtes entre dans sa ferme. J'ajoute que le mouvement du matin, qui amène les bêtes à faire leurs besoins, évIte de souiller la cour et la route. Au départ, dans le village, je prends la tête du troupeau, me retournant souvent pour le surveiller. Arrivé aux champs, je reste sur le côté gauche, à l'arrière de la troupe, accompagné de mon chien de pied.
A la main, j'ai une "marotte". C'est un bâton muni d'un crochet à une extrémité. Dans une touffe d'épine noire, j'ai repéré un beau brin droit, à la base duquel part un brin plus fin. J'ai coupé le brin le plus fort sous le départ du plus faible et j'en ai fait une marotte (une sorte de canne). Il arrive qu'on ait besoin d'immobiliser une brebis pour l'examiner, parce qu'elle boite ou qu'elle tousse ou qu'elle respire difficilement, pour lui donner des soins. Il n'est pas facile de l'attraper à mains nues. Alors, de la main droite, avec le crochet de la marotte,, je saisis la patte postérieure droite, la main gauche serrant une poignée de laine au flanc gauche. La brebis est immobilisée.
En 1939, je, remplace la marotte par une houlette que m'a apportée le berger de Cuperly. Je laisse à Jean de Brie le soin de vous la présenter. A la demande du roi Charles V, dit e Sage, Jehan de Brie a rédigé, vers 1379, le premier traI é important sur l'art de la bergerie. Il y décrit ainsi a houlette : Il ... la hante de la houlette doit estre en nefflier, ou d'aultre bois dur et ferme. Au premier bout de la hant e, ou baston doit estre le fer dessusdict concave et un peu courbe pour coper et houler la terre légère sur les brebis : car de houler (jeter, lancer) est-elle dicte houlette. A l'autre bout de dessoubz doit estre ung crochet de fust, de la nature et essence du bois du manche mesmes, qui tel le peult trouver (c'est ma marotte), et si non, si soit faict le crochet par adicion d'ung trou ou d'une cheville de estrange bois. Par ce crochet du bout de la houlette sont prises, tenues et acrochées les brebis et les aigneaux, pour visiter s'il y a, rongne et oingdre, pour seigner et mettre à obéissance, et pour y pourvoir de remède ... Il (8.10).
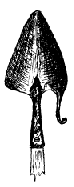
LES TERRAINS DE PATURE
Revenons à nos moutons. Ce sont des brebis élevées pour leur laine et les agneaux qu'elles produisent. Leur gestation dure cinq mois et elles nourrissent leurs agneaux trois mois. C'est dire la nécessité de leur assurer une alimentation régulière, copieuse et riche. A la bergerie, en hiver, il est assez facile d'y pourvoir. A la belle saison, en pâture, le problème est tout différent que, seul, l'art du berger résout au mieux. Mon souci quotidien est de rentrer avec des bêtes bien "remplies". Vous savez que les moutons sont des ruminants, qu'ils remplissent la grande poche de leur estomac, la panse ou rumen, où se produisent des fermentations dégageant du gaz carbonique. Ensuite,, au repos, ils ruminent., c'est-à-dire qu'ils mastiquent longuement les aliments remontant de la panse pour les envoyer ensuite dans le bonnet, de là dans le feuillet, enfin dans la caillette. Après ce séjour dans les quatre poches de l'estomac, l'herbe est définitivement digérée dans l'intestin. Je rentre donc, le soir,. avec des bêtes la panse pleine. Pour cela, il a fallu conduire le troupeau dans des lieux convenables.
